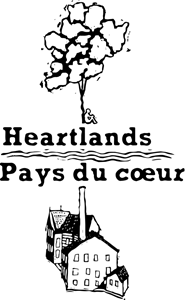Balade audio-guidée : paysages littéraires de l’Estrie et des Cantons-de-L’Est
Sur cette page vous trouverez des liens vers une balade audio-guidée, quelques documents annexes (en version courte ou longue), la transcription du texte de la balade (narration principale) et des photographies de l’itinéraire. Ceri Morgan a conçu et composé le texte de la balade comme une introduction à la littérature, la géographie et l’histoire de l’Estrie et des Cantons-de-l’Est. En collaboration avec l’artiste multimédia Phillip Lichti, elle avoulu créer une riche expérience auditive en intégrant sa narration au paysage sonore ambiant. Consciente de ne pas être du pays (bien que très bien accueillie) elle a tenu à inclure des extraits d’entretiens d’histoire orale recueillis par son assistante de projet, Eleni Polychronakos, auprès de ses résidents d’hier et d’aujourd’hui (avec leur permission). Le résultat est une balade audio-guidée qui convie ses auditeurs à un voyage entre passé et présent, et lecture et écriture, en passant par d’autres formes d’expression artistique – notamment plusieurs invitations à la création tout au long du parcours. La balade audio-guidée peut s’écouter en marchant (ou en mouvement, plus largement) mais aussi assis, debout ou allongé. Bien que cette œuvre ait été conçue en vue d’un itinéraire spécifique, elle se veut suffisamment ouverte pour que l’on puisse en profiter ailleurs, comme cela s’est fait lors d’une promenade collective le long du lac du campus de l’université de Keele en juillet 2024.
Scénario
00:08
Introduction
Je m’appelle Ceri Morgan et je vous invite à me rejoindre pour cette balade audioguidée issue d’un projet de recherche intitulé « Heartlands/Pays du cœur : Geohumanities and Québec’s ‘regional’ fiction ». « Heartlands/Pays du cœur » porte spécifiquement sur la région de l’Estrie et des Cantons-de-l’Est, au sud-est du Québec. Vu la taille de cette région, le parcours d’environ 2 km de cette balade audioguidée est symbolique : bien que le site que nous allons traverser – la rive du lac à Magog – informe cette promenade, nous ferons également référence à des lieux plus lointains. Notre parcours commencera au Bâtiment Billy Connor, près de l’aire de jeux du parc de la pointe Merry, à Magog. Le Bâtiment Billy Connor est un club de sport indiqué par une pancarte avec les inscriptions « Club été » et « Halte de la patinoire ». Nous prendrons ensuite le sentier piétonnier en direction du mont Orford et longerons le lac Memphrémagog pendant une cinquantaine de minutes – vous aurez constamment le lac sur votre gauche. Notre parcours se terminera dans l’aire de pique-nique du parc de la Baie-de-Magog, près de la grande sculpture en bronze d’André Desjardins, « Libre ». Après cette introduction, les différentes parties du parcours seront divisées en 5 sections, suivies d’une conclusion. Des cris d’oie marqueront le passage d’une section à l’autre. Vous pouvez faire cette promenade à votre rythme : n’hésitez pas à vous arrêter, à vous asseoir, à prendre une pause, à faire des retours en arrière ou à sauter certaines sections. Cette balade a été conçue comme un accompagnement, plutôt que comme un guide.
02:55
Phase 1
Je suis une femme des vallées du sud du Pays de Galles, région du Royaume-Uni autrefois connue pour ses mines de charbon. J’ai grandi dans une maison pleine de livres. Je suis aussi Québécoise d’adoption. À 21 ans, j’ai lu Kamouraska d’Anne Hébert pour un cours à l’université et je suis tombée amoureuse des paysages du Bas-Saint-Laurent. Depuis ce moment-là, je travaille sur la fiction québécoise.
Je vous invite en promenade avec certains de ces textes et l’histoire qui les a façonnés. Quand je dis « promenade », c’est pour évoquer toutes sortes de mobilités – comme me l’a appris Sue Porter, on peut flâner en chaise roulante (2015). On peut aussi se promener sur place ou par l’imagination. Vous serez parfois conviés à faire appel à votre créativité face à certaines des choses que vous verrez ou entendrez : libre à vous d’accepter ou de refuser.
Comme je l’ai déjà expliqué, la littérature de l’Estrie et des Cantons-de-l’Est accompagnera notre parcours. Fondée en 1981, la région administrative de l’Estrie est plus petite que celle des Cantons-de-l’Est : les « Eastern Townships », comme on appelle cette région en anglais, remontent à la fin du XVIIIe siècle, quand le gouvernement britannique utilisait le terme « township » pour désigner un territoire de 10 miles sur 10 miles.
Aux confins des États-Unis, l’Estrie et les Cantons-de-l’Est sont souvent perçus comme une région loyaliste, mais en réalité les W8banakiak (Wobanakis) s’y retrouvaient en certaines saisons, avant de s’y installer de façon plus permanente longtemps avant l’arrivée des colons américains. Avec ses chasses abondantes et son réseau de voies navigables, cette région était propice aux échanges, aux rassemblements et aux festivités. Cette présence autochtone est attestée par certains noms de lieux, notamment « Memphrémagog », adaptation de « mamhlawbagak » qui signifie « grande étendue d’eau ».
Les premiers colons non autochtones des territoires correspondant actuellement à l’Estrie et aux Cantons-de-l’Est sont arrivés d’Amérique, puis de Grande Bretagne et d’ailleurs en Europe dès la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècles. Ainsi, tout au long de son histoire, cette région a été un lieu de repos, de retrouvailles entre amis ou en famille, de loisirs et de tourisme. Aujourd’hui, elle accueille des touristes venus du Québec, du Canada ou des États-Unis, voire de plus loin encore pour y faire du ski, du vélo, de la natation, de la voile, de la marche ou des pique-niques, et déguster les spécialités locales au rythme des saisons.
Mon projet de recherche est né de ma curiosité envers ce que j’appelle les « Pays du cœur du Québec littéraire », en insistant sur le mot « cœur » pour souligner les émotions que certains lieux peuvent susciter et attiser. Le XXIe siècle a vu les écrivaines québécoises et écrivains québécois, en particulier les auteures et auteurs d’expression française, s’enthousiasmer pour des régions comme la Gaspésie, Saguenay ou la Côte-Nord. Ce régionalisme représente une nouvelle tendance, la littérature d’expression française et d’expression anglaise des 50 ou 60 dernières années s’étant généralement plutôt concentrée sur Montréal. À la différence des autres régions du Québec, le monde entier sait depuis plus de 60 ans que les Cantons-de-l’Est sont un lieu de création littéraire dans les deux langues majoritaires du Québec. Un mouvement poétique surtout d’expression anglaise s’est épanoui dans cette région dans les années 1960 (Camlot et Luxton, cité dans Morgan 2017). Il comptait des écrivains célèbres, notamment Ralph Gustafson, D. G. Jones et Michael Ondaatje. Ces poètes vivaient à North Hatley ou possédaient un chalet dans les environs, et plusieurs d’entre eux travaillaient au Collège Champlain, à l’Université Bishop’s ou à l’Université de Sherbrooke. Aujourd’hui, l’Estrie et les Cantons-de-l’Est sont toujours des lieux de création et de performance poétique d’expression française et d’expression anglaise : je citerais en particulier Danielle Dussault, Jean-François Létourneau, Mélanie Bué (alias LEM), Angela Leuck, Steve Luxton et Tanya Standish McIntyre. Depuis quelques années, toutefois, on associe plus particulièrement cette région à la fiction, notamment la fiction littéraire et la littérature de genre. C’est donc surtout de fiction et de textes littéraires en prose qu’il s’agira au cours de cette promenade.
Suivez le sentier au-delà de l’aire de jeux, du terrain de volleyball et du snack-bar. Arrêtez-vous un moment près des tables de pique-nique et de la billetterie. Regardez le lac Memphrémagog, puis le quai Macpherson et la tour d’observation au bout du quai. Je vous invite à réfléchir aux cimes et aux profondeurs. La nature est très présente ici – les chiens promènent leurs maîtresses et leur maîtres, la rive du lac est parsemée de bouleaux blancs et de trembles tout tremblants, un faucon s’efforce de tenir les pigeons à distance, les libellules fusent dans le ciel et les perches dans l’eau. Les espaces verts et le bleu des plans d’eau peuvent nous inviter à nous interroger sur ce qu’est une « commune », une « ville » ou un « centre urbain ».
Mettez le balado en pause et écrivez quelques lignes sur la nature autour de vous, ou bien faites un dessin, prenez une photo, filmez une petite scène ou enregistrez ses bruits. Vous pouvez aussi imaginer les créatures fantastiques qui se cachent dans les montagnes ou sous l’eau, comme Memphré, le monstrueux serpent de mer censé vivre dans le lac. Gardez le balado en pause si vous souhaitez donner libre cours à votre créativité en répondant à ces suggestions.
Un dragon s’anime dans la trilogie de Michèle Plomer, Dragonville. Capable de toutes les métamorphoses, cette créature est capable de prendre forme humaine, géologique ou fantastique. Dans les romans de cette trilogie, l’eau des lacs et de la mer relie le Hong Kong du début du XXe siècle, les Highlands de l’Écosse du XIXe et l’Estrie du XXIe siècle. De même, Memphré hante le roman jeune adulte d’Anne Brigitte Renaud et Michèle Plomer intitulé À l’eau. Le doute qui plane sur l’existence de ce monstre ajoute un frisson aux baignades du personnage principal, une adolescente qui passe l’été à Magog pour se remettre d’un accident de patinage et finit par s’impliquer sans le vouloir dans un complot international.
12:36
Phase 2
Suivons maintenant le sentier qui zigzague entre les plates-bandes jusqu’au quai. Jetez un coup d’œil à l’ancienne billetterie de l’Orford Express sur votre droite. Ce train touristique reliait autrefois Magog et Sherbrooke certains mois de l’année et permettait à ses passagers de savourer un repas gastronomique. Aujourd’hui, les trains de voyageurs ne circulent plus dans cette partie de la région. En revanche, les trains de marchandise font toujours partie du paysage sonore de la vie de tous les jours. D’ailleurs, dans la nouvelle de Liane Keightley, ‘Triton and Tex’, nous les entendons passer chaque fois que les murs de la maison du personnage principal se mettent à trembler. Les trains internationaux de cette nouvelle semblent venir de nulle part avec leurs noms passe-partout. Ils sont bien différents des chemins de fer du roman partiellement historique de Nick Fonda, Murder on the Orford Mountain Railway. Alors que les trains de Nick Fonda s’apprêtent à convoyer leurs passagers et leur cargaison sur des rails fraichement posés à la fin du XIXe et au début du XXe siècles, ceux de Liane Keightley ne font que passer, comme les voitures qui circulent en continu sur une route voisine.
Je vous propose un petit détour par le quai MacPherson. Continuez jusqu’au bout du quai, en tenant votre gauche par rapport à la billetterie en face de vous. Faites une pause au bout du quai ou montez les marches de la tour Memphré, jusqu’à la plateforme d’observation de cette tour panoramique. Songez à tous ces trajets qui se répètent, qui vous ramènent à la case départ ou qui tournent en rond, et aux sentiments de frustration et/ou de plaisir qu’ils peuvent provoquer. Imaginez un tel périple par écrit ou par le dessin, la parole ou un enregistrement : où voudriez-vous aller (ou tenter d’aller) ? Avec quel mode de transport ? Voudriez-vous faire de l’aviron sur le lac Memphrémagog, comme Louise Abbott dans son texte « Water Baby », ou skier sur le mont-Orford? Ou aimeriez-vous multiplier les allers-retours à Montréal, tels ces détectives qui font régulièrement Montréal – les Cantons-de-l’Est en l’espace d’une journée dans les romans policiers de Louise Penny et Johanne Seymour? Encore une fois, n’hésitez pas à garder le balado en pause aussi longtemps que vous le souhaitez.
17:23
Phase 3
Tournons-nous vers les loisirs et le travail. Le roman de Nick Fonda évoque l’histoire industrielle de l’Estrie et des Cantons-de-l’Est. Guy Laperrière et François Thierry Toé nous apprennent que la région accueillait autrefois des exploitations minières, des usines de papier, de pâte à papier et d’amiante (Laperrière 2009), ainsi que des usines ferroviaires et textiles (Toé 2016). Selon Toé, les progrès technologiques des pays d’outre-mer, l’externalisation du travail et un certain nombre d’autres facteurs entraînèrent une vague de désindustrialisation dont les premières conséquences se firent sentir dans les années 1950 (Toé 2016). Comme l’observe Jean-Pierre Kesteman, au tournant du millénaire, la région partageait un certain nombre de caractéristiques associées à la désindustrialisation dans le monde entier, notamment le déclin des petites villes, le chômage et l’exode des jeunes (Kesteman 2006). Les centres-villes de la région se dépeuplèrent dans les petites villes comme dans les grandes agglomérations. Comme Paul, l’archiviste et historien local qui est le personnage principal du roman de Patrick Nicol, Les Manifestations, nous pouvons faire un tour à la Marquette, dans le centre-ville historique de Sherbrooke. Donnez libre cours à votre imagination, pour reconstruire les maisons – aujourd’hui démolies et remplacées par des parkings – qui avoisinaient autrefois le lieu de travail des ouvrières et des ouvriers. Pensez à la laine qui se filait à l’usine Paton ou aux bas fabriqués chez Kayser. Continuez au-delà du ponton d’embarquement et de la billetterie pour diverses activités aquatiques et de loisirs. Ralentissez le pas un moment. Et imaginez les sons, les odeurs, et les textures de l’ère industrielle.
La région conserve bien sûr toujours une partie de son industrie lourde et légère, notamment les usines de graviers à Stanstead. Et il faut veiller à ne pas idéaliser les conditions de travail souvent malsaines ou dangereuses des ouvrières et des ouvriers. La poussière qui s’accumule partout et qu’il faut sans cesse épousseter est une image récurrente dans le roman de Robert Lessard intitulé Pat, mineur d’Asbestos. Et dans Qu’il est bon de se noyer, un roman de Cassie Bérard situé dans la ville d’Asbestos (aujourd’hui rebaptisée Val-des-Sources), l’ancienne mine d’amiante engloutit une partie de la ville. Les nouvelles industries de la région, en particulier l’artisanat et les produits de l’agriculture biologique (fromages, légumes, vins et bière) se fraient également leur place dans les pages de quelques romans, comme Ça peut pas être pire… de Nathalie Roy ou Des Réguines et des hommes de Julie Myre-Bisaillon.
21:38
Phase 4
En rejoignant le sentier piétonnier principal du parc, vous verrez un panneau d’information avec une carte de la rive du lac indiquant les parkings (stationnement du Moulin et stationnement Cabana) et la plage des Cantons. Tournez à gauche et continuez en direction du mont Orford. Réfléchissons aux cartes, avec leurs lignes et leurs contours : que révèlent-elles et que recèlent-elles ? Que conjurent-elles et qu’effacent-elles ?
La ligne frontalière entre le Québec (le Canada) et les États-Unis traverse le lac Memphrémagog, mais les comportements individuels et collectifs remettent régulièrement en question le sens et l’autorité de cette frontière. Et puis cette frontière n’a bien sûr pas de sens pour les animaux, les plantes et toutes les formes de vie naturelles.
La nature arbitraire et contestée de la frontière est un des thèmes de Dixie. Dans ce roman atmosphérique, William S. Messier présente une frontière poreuse que les animaux, les gens et les biens traversent clandestinement, voire légalement, ni vus ni connus. Comme Dragonville, Dixie retrace fictivement la diversité actuelle et historique des identités nationales et ethniques de l’Estrie et des Cantons-de-l’Est : la famille blanche du personnage principal – Gervais Huot, un enfant de 7 ans – est originaire des Pays Bas ; le prisonnier évadé qu’il rencontre vient des États-Unis ; et le garde-frontière et professeur de banjo local Léandre Pelletier est Noir. Le roman fait également référence au cimetière historique de Saint-Armand, où les Noirs libres et esclaves étaient enterrés autrefois.
La région de l’Estrie et des Cantons-de-l’Est est linguistiquement mixte : bien que la langue dominante des villes et des villages soit souvent le français ou l’anglais, l’éventail des langues peut aussi être plus large : Sherbrooke, par exemple, est un pôle d’immigration du Québec et a été reconnue pôle d’accueil pour les réfugiés en 1993. Les textes de fiction et de non-fiction de la région mettent souvent en scène des échanges mêlant le français et l’anglais, comme dans les interactions de la vie de tous les jours. Certaines œuvres attestent de la présence d’autres langues, notamment le hollandais et le créole louisianais dans Dixie, l’italien dans Murder on the Orford Mountain Railway, le mandarin dans Dragonville, et l’espagnol mexicain dans À l’eau. La richesse linguistique des paysages littéraires de ces textes fait écho à celle d’une région qui se veut à la fois pôle d’immigration et destination touristique.
Nous avons atteint la Place Memphré, près du passage à niveau. Le belvédère a un escalier et une rampe d’accès. Prenez cette rampe pour monter ou bien descendez sur la plage, dite Plage de l’ouest. L’air est souvent marin ici. Touchez le sable et l’eau, ou écoutez le bruit des pas sur les pavés du sentier ou sur les lattes en bois de la plateforme d’observation. Quelles sensations provoquent en vous les surfaces qui sont sous vos pieds ou sous vos roues ? Mettez le balado en pause et écrivez, dessinez, enregistrez, photographiez ou filmez un paysage sensoriel : ne vous sentez pas obligés de vous confiner à la vue, à l’odorat, à l’ouïe ou au toucher. Les goûts abondent dans les textes de la région, des glaces de Coaticook, dans À l’eau, à la tarte au sucre, dans The Cruellest Month de Louise Penny.
27:09
Phase 5
Continuez en direction du mont-Orford, au-delà de l’horloge, de la sculpture/fontaine végétale de Memphré sur votre droite et d’une autre plateforme d’observation sur votre gauche. C’est la partie la plus longue de notre parcours. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous reposer sur un des nombreux bancs qui bordent le sentier devant le restaurant et l’hôtel, par exemple. Réfléchissons un peu plus aux plantes, aux animaux et à la terre. Les arbres sont partout dans la géographie réelle et littéraire de l’Estrie et des Cantons-de-l’Est, malgré la déforestation entraînée par la colonisation, les exploitations forestières, les usines de papier et de pâte à papier, et les centrales hydroélectriques qui alimentent les industries manufacturières de la région. Dans les premières pages de Still Life, de Louise Penny, nous découvrons le corps inerte de la victime d’un meurtre sur un lit de feuilles d’automne; dans Blindshot, de Denis Coupal, des agents de police sillonnent les routes bordées d’arbres d’une région où tout le monde se fait la guerre; et dans En rampant, de David Clerson, des enfants jouent dans les cabanes et les maisons abandonnées dans les bois. Ces arbres littéraires peuvent s’envisager comme des sentinelles ou des témoins. Plusieurs écrivaines et écrivains jouent sur le contraste entre la beauté de la nature dans l’Estrie et les Cantons-de-l’Est, et la violence ou la menace que ces paysages peuvent receler. Le village de Three Pines où Louise Penny situe ses romans policiers exemplifie ce phénomène avec son parc, son plan d’eau, son église, sa librairie, sa boulangerie et son bistro qui fait gîte du passant. Fondé par des loyalistes, Three Pines donne l’impression d’un refuge paisible et idyllique où tout le monde est la bienvenue et se soutient mutuellement. Le mélange d’anglophones et de francophones de la population du village évoque la diversité ethnolinguistique réelle des Cantons-de-L’Est. De même, certains des personnages principaux – notamment un couple gai et une psychologue Noire reconvertie en libraire – incarnent la diversité sociale de la région. Or, Three Pines est un village en dehors du réseau non seulement parce qu’il n’a pas de couverture cellulaire, mais aussi parce que son nom ne figure pas sur les cartes routières : la plupart de ces visiteurs le découvrent par hasard, au détour des routes. C’est donc presque un monde de conte de fées, loin des pressions et des contraintes de la vie quotidienne, qui happe les lectrices et les lecteurs. Mais cette belle image s’avère trompeuse quand les corps des victimes se mettent à s’empiler dans les nombreux romans de cette série.
Si la beauté de la nature forme l’arrière-plan de nombreux romans, d’autres présentent au contraire des paysages dégradés. Ainsi, les cinq romans policiers de la série Kate McDougall, de Johanne Seymour, décrivent un monde banal et souvent sombre avec ses lacs et ses forêts lugubres, ses restaurants de fast-food, ses chantiers de ferraille, et Perkins, le village imaginaire dénué de charme où elle situe le commissariat central. Exemples du noir rural Québécois, les romans de Seymour retracent le déclin économique de la région, comme l’indique un hôtel dilapidé abandonné des touristes depuis la construction d’une nouvelle route.
Les paysages dégradés qu’on trouve dans certains romans écrits ou situés dans l’Estrie et les Cantons-de-l’Est mettent en lumière l’impact de l’être humain sur l’environnement. Dans ce contexte, la criminalité, c’est la destruction de la nature. Ouvrir son cœur, d’Alexie Morin, retrace par exemple la dévastation qu’entraînent les usines à papier qui se cachent dans les bois. Dans d’autres livres, la nature semble au contraire se venger de nous, humains, et de nos pratiques d’extraction. Mêlant le roman policier au western, le roman de Denis Coupal, Blindshot, peut se lire comme un avertissement à celles et à ceux qui voudraient réduire la région à une aire de loisirs, à un terrain de chasse aux trophées ou à une mine d’or à exploiter sans scrupules. Dans d’autres textes, la nature est tout simplement indifférente à l’activité humaine. Ainsi, ce coyote qui traverse nonchalamment la frontière dans Dixie, de William Messier ; ou ce maïs dont l’exubérance semble insupportable à la protagoniste de la nouvelle de Liane Keightley, « Ten-Cent Packs », dans Seven Openings of the Head.
Je vous invite à réfléchir à tout ce qui est défendu et à interroger ces interdictions. Retournez un peu sur vos pas, si vous le voulez bien, et regardez toutes ces pancartes qui bordent la rive du lac : « Défense de nager », « Défense de fumer », « Vapotage interdit »… – ces deux dernières peuvent d’ailleurs paraître particulièrement ironiques, vu que la fabrication des allumettes était autrefois une industrie régionale. Mettez le balado en pause et proposez quelques alternatives à ces interdictions. Quels sont les comportements que vous aimeriez encourager? Si vous le préférez, vous pouvez composer un poème trouvé à partir des mots d’un ou plusieurs panneaux d’information. Choisissez 12 mots qui vous parlent et arrangez-les à votre guise. Vous pouvez aussi adopter la forme suivante : 3 mots au premier vers ; 2 mots au deuxième vers ; 1 mot au troisième vers ; 1 mot au quatrième vers ; 2 mots au cinquième vers ; 3 mots au sixième vers. Cela donne un résultat harmonieux sur la page, mais libre à vous de choisir la forme que vous préférez.
Vous avez sûrement remarqué les oriflammes avec des citations littéraires au bord du sentier. Nous sommes maintenant dans la section du parc baptisée « Paroles d’ici » lors d’un projet organisé par Magog Culture en l’honneur de plusieurs écrivaines, écrivains et artistes de la région. Vous trouverez leurs textes dans la Bibliothèque Memphrémagog. Située dans l’Église Sainte-Marguerite-Marie, avec ses beaux vitraux et leurs motifs de marguerites, la bibliothèque de Magog se trouve dans le quartier des Tisserands. La maison Merry, musée situé dans la plus vieille maison du Magog urbain, évoque également l’histoire industrielle de la ville. Construite par Ralph Merry III, un Américain qui s’est battu aux côtés des troupes révolutionnaires, la maison Merry a été érigée sur un terrain ayant appartenu à Nicholas Austin, un loyaliste propriétaire d’Outlet à la Pointe Merry, un ancien moulin où il avait installé une meunerie et une scierie.
Prenez le temps de lire les citations sur les oriflammes qui bordent le sentier, puis dirigez-vous vers les tables de pique-nique. Choisissez une de ces citations, et répondez-y par un texte, une photographie, une chanson, un enregistrement sonore ou un dessin – comme vous préférez – en donnant libre cours à votre créativité. Quelle citation avez-vous choisie ? Pourquoi ? Gardez le balado en pause aussi longtemps que vous le souhaitez et réfléchissez un moment au pouvoir de l’écriture et de l’art sur notre perception du monde.
39:55
Conclusion
Continuez vers le mont Orford, avec le parking (le stationnement Cabana) sur votre droite. Regardez l’espace vert sur la gauche du sentier pavé – une sculpture en bronze se cache parmi les arbres. De la fiction littéraire à l’écriture contre-culturelle, de la « chick lit » à la science-fiction, et des romans policiers aux mémoires, les textes de fiction et de non-fiction de l’Estrie et des Cantons-de-l’Est sont d’une grande diversité. Toute cette littérature nous propose des centaines de façons de penser cette région et d’y vivre. Renversant les idées préconçues sur les querelles de clocher et le nombrilisme de la littérature régionale, cette littérature de l’Estrie et des Cantons-de-l’Est au XXIe siècle est ambitieuse, ouverte sur le monde extérieur, et souvent joyeuse – même quand elle traite de sujets épouvantables. Ces centaines de livres ont tous un point commun : leur attachement à la région dans laquelle ils se situent. C’est un attachement que je partage aussi grâce aux plaisirs de la lecture et de la conversation dans les cafés qui bordent le lac, dans les bois et dans les studios d’enregistrement de ce beau pays.
J’attends le bus au crépuscule devant le petit café qui ne sert rien d’autre à boire que du café filtre, des boissons gazeuses et du thé Red Rose. Je décide de prendre un thé et la serveuse le pose sur la table en indiquant le sucre et la crème du petit doigt. Je cherche en vain du lait sans oser en demander. La serveuse est déjà en train de servir de la poutine à un autre client. Il doit être évident pour les habitués que je ne suis pas d’ici, mais on m’accepte sans commentaire. Personne ne me regarde.
42:45
Remerciements
Composition et lecture du scénario par Ceri Morgan, avec des extraits d’entretiens d’histoire orale réalisés par Eleni Polychronakos auprès d’habitant.e.s de la région.
Traduction vers le français de Margaret Rigaud.
Prise de son par Philip Lichti, avec la collaboration de Kelcey Swain et Yannick Guéguen.
Enregistrement réalisé dans les Birmingham Podcast Studios, au Royaume-Uni.
Cette balade audio-guidée et les recherches qui la fondent ont bénéficié du soutien d’un Leadership Fellowship du Arts and Humanities Research Council. Ce projet s’accompagne d’une carte en ligne avec des lectures d’extraits de romans et de mémoires situés dans l’Estrie et les Cantons-de-l’Est. Tout comme le balado, cette carte ne mentionne qu’une fraction des centaines de textes situés dans la région et ne constitue donc qu’un petit aperçu de la diversité de ses paysages littéraires.
Je remercie les consultantes du projet, Rachel Bouvet et Cheryl Gosselin, et le consultant du projet, Julien Bourbeau.
Je tiens également à remercier la Traversée, atelier de géopoétique, la Ville de Magog (Section patrimoine et culture), ainsi que la maison Merry, et surtout Anne Brigitte Renaud et Marie Lemonnier.
Merci au Conseil des Abénakis d’Odanak/Abenaki Council of Odanak pour les corrections qu’ils ont apportées à certaines sections du texte.
Merci aussi à toutes les écrivaines et à tous les écrivains qui ont directement participé à ce projet pour leurs mots, leur expertise et leur générosité.
Je tiens également à exprimer ma reconnaissance à toutes celles, et à tous ceux qui ont gentiment accepté de partager leurs connaissances et leurs expériences lors de nos entretiens d’histoire orale.
Merci beaucoup à Eleni Polychronakos, assistante de recherche pour ce projet.
Un grand merci aussi à Sarah Burgoyne pour nos discussions qui m’ont aidée à donner forme à ce balado.
Ce parcours ayant été conçu à la fin d’un automne particulièrement doux, et le scénario ayant été conçu puis revu au début et au milieu de l’été, le balado semblera peut-être décrire un rêve pendant les mois d’hiver.
J’en profite également pour dire toute ma reconnaissance aux écrivaines et aux écrivains qui ont écrit sur l’Estrie et les Cantons-de-l’Est pour le plaisir que leurs livres me donnent depuis tant d’années.
Enfin, je remercie les habitantes et les habitants de l’Estrie et les Cantons-de-l’Est de m’avoir si bien accueillie lorsque je suis loin de chez moi.
Liste de références
Abbott, Louise, « The Life and Times of a Water Baby », dans Water Lines : New
Writing from the Eastern Townships of Quebec, dir. Angela Leuck (Georgeville, QC : Studio Georgeville, 2019), pp.77-81
Bérard, Cassie, Qu’il est bon de se noyer (Montréal : Éditions Druide, 2016)
Clerson, David, En rampant (Montréal : Heliotrope, 2016)
Coupal, Denis, Blindshot (Montréal : Linda Leith Publishing, 2019)
Fonda, Nick, Murder on the Orford Mountain Railway (Montréal : Baraka Books,
2021)
Hebert, Anne, Kamouraska (Paris : Éditions du Seuil, 1970)
Keightley, Liane, «Triton and Tex», «Ten-Cent Packs », dans Seven Openings of the
Head (Montréal : Conundrum Press, 2007)
Kesteman, Jean-Pierre, « Ruralité et mondialisation dans les Cantons-de-l’Est du
Québec. Le regard de l’historien, » Journal of Eastern Townships Studies, 29-30 (2006), 5-20.
Laperrière, Guy, Les Cantons-de-l’Est (Québec, QC : Presses de l’Université Laval,
2009)
Lessard, Robert, Pat, mineur d’Asbestos (Sherbrooke, QC : Éditions Naaman, 1987)
Messier, William S., Dixie (Montréal : Éditions Marchand de feuilles, 2013)
Morgan, Ceri, Writing, Talking and Walking Québec’s Eastern Townships (London :
The British Library, 2017)
Morin, Alexie, Ouvrir son cœur (Montréal : Le Quartanier, 2018)
Myre-Bisaillon, Julie, Des réguines et des hommes (Montréal : Hurtubise, 2018)
Nicol, Patrick, Les Manifestations (Montréal : Le Quartanier, 2019)
Penny, Louise, The Cruellest Month (Londres : Headline, 2007)
_____, Still Life (Londres : Headline, 2005)
Plomer, Michèle, Dragonville (Montréal : Éditions Marchand de feuilles, 2011-13)
Porter, Sue, « Walking in someone else’s shoes », Walking Studies Today workshop,
Keele University, 26 May 2015
Renaud, Anne Brigitte, et Michèle Plomer, À l’eau (Magog, QC : Éditions Chauve-
souris, 2020)
Roy, Nathalie, Ça peut pas être pire (Montréal : Éditions Libre Expression, 2016)
Seymour, Johanne, Le cri du cerf (Outremont, QC : Éditions Libre Expression, 2005)
Toé, François Thierry, « Trame historique du textile à Coaticook (1971 à nos jours) »,
Journal of Eastern Townships Studies, 46 (2016), 59-74
Ce projet de recherche bénéficie du soutien du Arts and Humanities Research Council (Leadership Fellowship, numéro de subvention : AH/T006250/1]. Ethics approval number : 0341